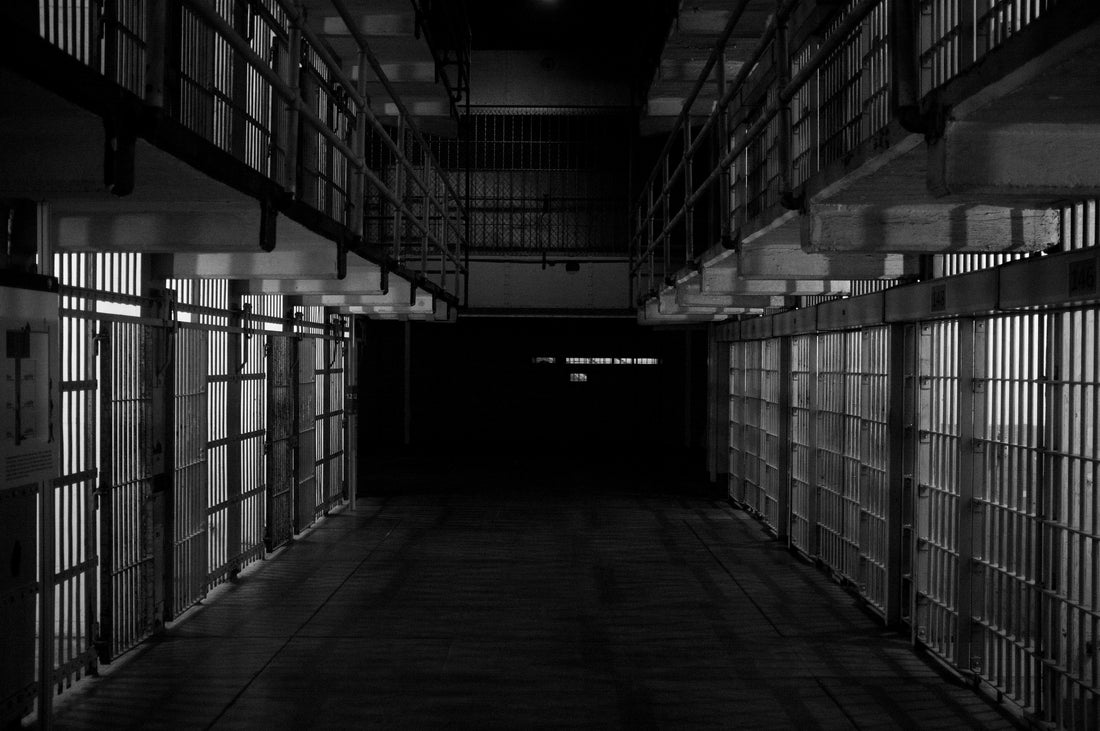
Écoutes téléphoniques, secret professionnel et condamnation de Nicolas Sarkozy : L’affaire Bismuth (commentaire)
Share
L’affaire Bismuth (Cdc crim, 18 décembre 2024)
Le 18 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy concernant l’affaire Bismuth, et confirmait l’arrêt d’appel le condamnant à une peine de 3 ans de prison dont 2 avec sursis. Les faits sont complexes, et la question de la retranscription des écoutes téléphoniques entre un avocat et son client interroge.
Quelles sont ici les infractions retenues, et quelle a été la position de la Cour de cassation concernant la retranscription des écoutes ?
Les faits d’espèce remontent à 2014, et gravitent en réalité autour d’une autre affaire judiciaire complexe, celle du financement de la campagne présidentielle de 2007. A l’époque, l’enquête avait permis de révéler que l’ex-président de la République entretenait une conversation secrète avec son avocat sous une ligne téléphonique attribuée au nom de « Paul Bismuth ». Cette ligne ayant été mise sous écoute, Maître Herzog et son client ont communiqué des informations laissant entendre qu’un magistrat, Gilbert Azibert, pouvait être impliqué dans un pacte de corruption : il s’agissait pour ce dernier de donner des renseignements sur les affaires judiciaires impliquant M. Sarkozy, en échange de quoi celui-ci lui permettrait d’obtenir un poste prestigieux à Monaco. Une information judiciaire fut donc ouverte en parallèle, pour les chefs de corruption, trafic d’influence et révélation du secret professionnel.
Nicolas Sarkozy a d’abord été condamné en première instance le 1er mars 2021 par le Tribunal Correctionnel de Paris, des chefs de corruption active et trafic d’influence actif. Son avocat fut en sus condamné de violation du secret professionnel, et le magistrat de la Cour de cassation de recel de violation du secret professionnel. Les mis en cause ayant interjeté appel de ce jugement, l’affaire fut renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris, laquelle les condamnait pour ces mêmes infractions le 17 mai 2023. Un pourvoi en cassation fut formé, portant cette affaire devant la troisième et dernière instance juridictionnelle, dont la décision de confirmation du verdict de la Cour d’appel, fut rendue le 18 décembre 2024.
I) Les infractions retenues
A) La corruption
La corruption, c’est user illégalement de sa fonction pour recevoir une contrepartie. Cette infraction implique qu’une personne A (le corrupteur) propose, à une personne B (le corrompu), des offres, promesses, dons ou avantages quelconques, en contrepartie de l’exécution (ou l’abstention) par B d’une mission réalisée dans le cadre de ses fonctions. Cette infraction n’implique pas forcément d’être réalisée à plusieurs, dans la mesure où la seule proposition de corruption, non acceptée par la personne sollicitée, demeure répréhensible. Toutefois, en cas d’accord entre le corrupteur et le corrompu, un pacte de corruption est alors conclu. On différencie donc la corruption active (corrupteur : fourniture d’un avantage en échange d’un service) de la corruption passive (corrompu : rend service en échange d’un avantage pour elle-même ou autrui). La notion d’activité et de passivité peut être confuse, mais il faut se rappeler que la personne rendant un service est toujours coupable de corruption passive, même si c’est lui qui a sollicité le corrupteur et proposé l’avantage. A l’inverse, celui qui fournit un avantage se rend responsable de corruption active, quand bien même il n’aurait fait que répondre aux sollicitations de l’agent corrompu. La corruption est punie de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction.
Dans le cas d’espèce, les conversations téléphoniques ont révélé la volonté de l’ancien président de la République et son avocat de tenter d’obtenir des informations concernant l’affaire Bettencourt auprès d’un magistrat, Gilbert Azibert, en contrepartie de quoi il faciliterait sa candidature pour un poste prestigieux à Monaco. La Cour de cassation a donc confirmé, dans son arrêt du 18 décembre 2024, la constitution du délit de corruption entre l’ancien président de la République, son avocat, et le magistrat ayant révélé des informations secrètes, sur la base légale de l’article 434-9 du code pénal.
À noter : L’article 434-9 CP vise l’infraction spéciale de corruption commise par membre du personnel judiciaire : un magistrat (1°), un fonctionnaire au greffe d’une juridiction (2°), un expert (3°), une personne chargée d’une mission de médiation ou conciliation (4°), ou une personne exerçant une mission d’arbitrage (5°). A défaut, le délit général de corruption trouve sa base légale sous les articles 432-11 et 433-1 en cas de corruption d’une personne dépositaire de l’autorité publique, ou sous les articles 445-1 et 445-2 CP en cas de corruption d’une personne privée.
B) Le trafic d’influence
Dans le trafic d’influence, ce qui fait l’objet du trafic c’est l’influence, et non plus la fonction. Il s’agit, pour une personne A, de demander à une personne B d’user de son influence « réelle ou supposée » en vue de peser sur le sens d’une décision ou d’un avis rendu par une personne C. En contrepartie, la personne A promet, donne ou offre un quelconque avantage à la personne B. Cette infraction, très proche de l’infraction de corruption, s’en distingue par son caractère tripartite : l’agent A offre un avantage en échange de la mise en œuvre de l’influence de l’agent B sur la personne C. Enfin, à l’instar de la corruption, le trafic d’influence actif consiste à rémunérer une personne en échange de l’abus de son influence sur autrui. Le trafic d’influence passif revient à abuser de son influence sur autrui en contrepartie d’un avantage. Le trafic d’influence est également puni de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction.
En l’espèce, l’ancien président de la République et son avocat auraient sollicité Gilbert Azibert, alors avocat général près la Cour de cassation, afin que celui-ci use de son influence auprès de ses collègues magistrats dans le cadre de l’affaire Bettencourt, dans le but d’obtenir une décision favorable. La Cour de cassation a donc reconnu Nicolas Sarkozy et Me Herzog coupables de trafic d’influence actif, et Gilbert Azibert de trafic d’influence passif.
C) La violation du secret professionnel
L’avocat, en raison de sa profession et des informations dont il aura connaissance, est soumis au secret professionnel. Le secret professionnel constitue le corollaire nécessaire de la confiance du client en la personne de son avocat, et couvre tous les échanges et correspondances entre l’avocat et son client (Art 2.2 RIN). En outre, en raison de la participation de l’avocat au sein de la procédure pénale, l’avocat doit également respecter le secret de l’enquête et de l’instruction (Art. 2 bis RIN ; Art. 11 Code de procédure pénale).
Dans le cas d’espèce, l’arrêt révèle qu’a été découvert, au cours d’une perquisition au sein du domicile du juge Azibert, un arrêt de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux. Le magistrat a indiqué que cet arrêt lui avait été transmis par Me Herzog qui, en sa qualité d’avocat, avait eu accès à cette pièce conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale.
Cet arrêt était-il couvert par le secret professionnel ? L’un des moyens élaborés par la défense lors du procès avait été d’avancer que les arrêts de la chambre d’instruction, notifiés aux parties et leurs avocats en application de l’article 217 du Code de procédure pénale, n’étaient pas couverts par l’instruction. Dès lors, c’était par simple curiosité doctrinale que l’avocat avait transmis cet arrêt à son collègue magistrat. Réfutant ce moyen de défense, les sages indiquent qu’à défaut d’être couvert par le secret de l’instruction, cette pièce de procédure notifiée à l’avocat « constitue une information à caractère secret dont l’avocat a eu communication en raison de sa profession, et dont la révélation est interdite en application de l’article 226-13 du Code pénal » (§68). L’avocat a donc été condamné du délit de violation du secret professionnel, et le magistrat de recel de violation du secret professionnel.
À noter : Le recel, c’est le fait de profiter du produit d’une infraction.
II) La recevabilité des transcriptions des conversations téléphoniques
Le point le plus débattu de cette affaire concerne sûrement la retranscription des conversations téléphoniques entre la personnalité politique et son ancien avocat. En effet, la ligne utilisée par « Paul Bismuth » et son avocat ayant été mise sur écoute, c’est principalement la transcription de celle-ci qui a fondé la condamnation de l’ancien président et son conseil par la Cour d’appel de Paris.
Pour rappel, les écoutes téléphoniques constituent un acte de procédure pénale relativement courant, dont le régime est fixé aux articles 100 à 100-8 du Code de procédure pénale. Pourtant, les conditions de mise sous écoute se durcissent lorsque l’un des interlocuteurs concernés est avocat. En effet, le secret des correspondances entre l’avocat et son client découle directement du principe des droits de la défense, protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
Par exemple : la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que les correspondances écrites entre un avocat et un détenu constituant un mode de correspondance protégé, elles ne pouvaient être lues par un membre de l’administration pénitentiaire, en raison des droits de la défense. Il s’agit d’une exception aux ingérences licites de la liberté de correspondance du détenu.
Concernant la mise sous écoute d’une ligne entre un avocat et son client, la Cour strasbourgeoise a posé un principe de confidentialité des correspondances entre un avocat et son client afin de garantir la bonne administration de la justice, et la relation de confiance entre eux (Arrêt Michaud c. France, 2012). Toutefois, tout principe pouvant être limité, l’article 100-7 du Code de procédure pénale permet la mise sous écoute de la ligne d’un avocat sous deux conditions : que le bâtonnier ait été informé, et qu’il existe des indices suggérant que l’avocat aurait participé à l’infraction.
Dans le cas d’espèce, le tribunal avait tout d’abord estimé, en première instance, que certaines des retranscriptions devaient être écartées, et ce afin de respecter les droits de la défense du mis en cause, faute d’indices révélant la participation de l’avocat à d’éventuelles infractions. La Cour d’appel de Paris est toutefois revenue sur cette décision en considérant que la régularité des écoutes ayant été examinée pendant la phase d’instruction, il n’était pas nécessaire de revenir dessus. La défense a donc fondé l’un de ses moyens sur cet aspect, en avançant une violation des droits de la défense du mis en cause ainsi que du secret professionnel de l’avocat, respectivement garantis par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Lors de l’examen en cassation, la Cour a considéré que ce moyen était inopérant, et a confirmé la régularité des retranscriptions puisque les deux conditions énoncées par l’article 100-7 du CPP, et imposées par la Cour européenne des droits de l’Homme, avaient été respectées.
Nicolas Sarkozy et son ancien avocat ayant d’ores et déjà annoncé saisir la Cour européenne des droits de l’Homme sur ce point, reste à savoir si les juges strasbourgeois seront du même avis de la Cour de cassation, et considèreront que les droits de la défense ont bien été respectés.
Guyonne Pierre // Titulaire d'un M2 en droit pénal comparé à l'Université de Bordeaux et admise au CRFPA
