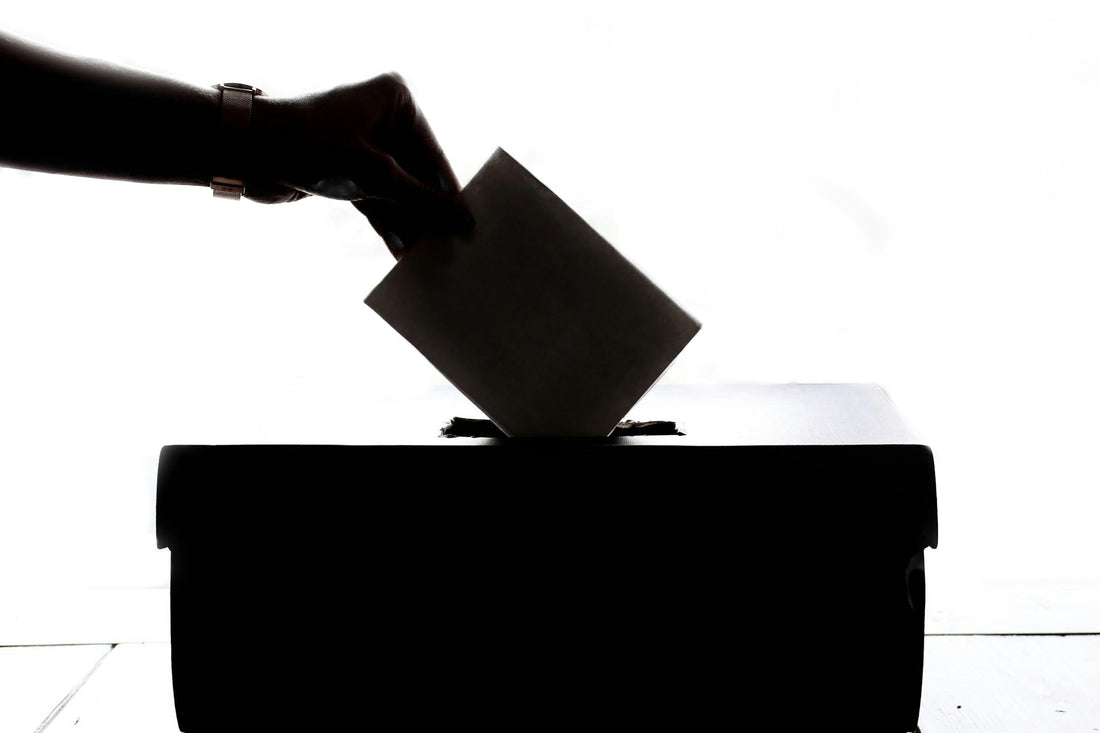
La peine d’inéligibilité
Share
Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournements de fonds publics. La lumière a en effet été faite sur un système d’emplois fictifs créé au sein du Parlement européen entre 2004 et 2016, les fonds récupérés étant en réalité destinés au financement du parti national. La juridiction a condamné la députée à quatre ans de prison, dont deux ans ferme, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité d’une durée de cinq années.
Afin de mettre au clair cette histoire, un focus sur la peine d’inéligibilité s’impose.
I) Comprendre la peine d’inéligibilité
A) Le but de la peine d’inéligibilité
Le droit de vote et d’être éligible font partie des droits civiques, droits dévolus aux citoyens (du latin « civis », signifiant le citoyen) compte tenu de son appartenance à l’organisation politique de l’Etat. Ceux-ci constituent donc des droits fondamentaux, inhérents à la nationalité française d’une personne. Ils garantissent notamment la participation du peuple à l’expression de la volonté générale (Art. 6 DDHC). Le Conseil constitutionnel rappelait en effet dans une décision de 1982 que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu » (§7).
Dès lors, la peine d’inéligibilité consiste à supprimer le droit d’être élu, et revenir sur certains droits civiques d’une personne. Cette peine est prononcée par une juridiction de jugement, et intervient en complément d’une peine principale (prison ferme ou sursis).
B ) La création de la peine d’inéligibilité
Quand a été instaurée la peine d’inéligibilité ?
En réalité, cette peine n’est pas récente, puisqu’elle apparaissait déjà dans le Code pénal napoléonien (article 42), promulgué en 1810. A l’adoption du code pénal de 1994, la peine d’inéligibilité fut introduite à l’article 131-26 2°, en tant qu’interdiction des droits civiques. L’alinéa 7 du même article précise que cette interdiction ne peut excéder une durée de 10 ans pour une condamnation pour crime, et 5 ans en cas de condamnation pour des faits délictuels. Toutefois, l’article 131-26-1 prévoit une dérogation à cette durée limitée, en fixant à 10 ans maximum la durée de l'inéligibilité à l’encontre d’une « personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits ».
C) Le domaine d’applicabilité de la peine d’inéligibilité
L’article 432-17 du code pénal précise le domaine dans lesquels cette peine peut être prononcée à titre complémentaire, à savoir en cas d’atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Cela inclut notamment l’infraction de prolongation illicite de fonction (article 432-3 Code pénal), les atteintes à la liberté individuelles commises par un fonctionnaire (article 432-4), les discriminations (article 432-7), les atteintes au secret des correspondances (article 432-9), ou certains manquements au devoir de probité tels que la concussion (article 432-10), la corruption ou le trafic d’influence commis par une personne exerçant une fonction publique (article 432-11), ou le détournement de biens (article 432-15), infraction dont fut reconnue coupable Marine Le Pen par le jugement du 31 mars 2025.
D) L’évolution de la peine d’inéligibilité
Suite au scandale généré par l’affaire Cahuzac en 2013, le Parlement a promulgué la loi Sapin II le 9 décembre 2016, sous le mandat de François Hollande. Cette loi, relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, est notamment venue modifier l’article 432-17 alinéa 6 du Code pénal, en indiquant que le « prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre ». La section 3 citée par l’article visait les manquements au devoir de probité, c’est-à-dire les infractions de concussion, de corruption passive et trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, la prise illégale d’intérêts, les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et contrats de concessions, ainsi que les soustractions et détournements de biens. Par cette loi, la peine d’inéligibilité a donc été rendue obligatoire à l’encontre d’une personne rendue coupable d’une des infractions de manquement au devoir de probité.
Pour aller encore plus loin, la loi ordinaire du 15 septembre pour la confiance dans la vie politique est venue élargir le champ d’applicabilité de la peine obligatoire d’inéligibilité. En effet, en supprimant l’alinéa 6 de l’article 432-17 du Code pénal, et créant l’article 131-26-2, la loi a rendu obligatoire la peine d'inéligibilité dans les cas où une personne aurait été rendue coupable d’un délit mentionné par l’article ou d’un crime. Parmi les délits mentionnés, sont notamment prévus les violences, les discriminations, les actes de terrorisme, ou encore le détournement de fonds publics (article 432-15) dont s’est rendue coupable Marine Le Pen. L’article 131-26-2 III précise que seule une décision spécialement motivée de la part de la juridiction, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, permettra de ne pas prononcer cette peine.
Evolution de la peine complémentaire d’inéligibilité :
II) L’application de la peine d’inéligibilité
A) La peine d’inéligibilité est-elle obligatoire ?
Certains s'interrogent sur le caractère obligatoire de la peine d’inéligibilité dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires.
Concernant les faits reprochés à Marine Le Pen en particulier, les recherches judiciaires ont révélé que les faits avaient duré jusqu’au mois de février 2016. Dès lors, les dispositions issues de la loi Sapin II, entrée en vigueur le 11 décembre 2016, ne trouvaient pas à s’appliquer. En effet, conformément aux principes d’application de la loi pénale dans le temps, les dispositions nouvelles ne peuvent s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. L’obligation d’une peine d’inéligibilité étant plus sévère que la seule option de celle-ci, c’est donc la version antérieure à la loi Sapin II qui trouvait à s’appliquer en l’espèce.
Les juges avaient donc la simple faculté, et non l’obligation, de recourir à cette peine. Puisque ces derniers ont toutefois décidé de la prononcer, le jugement fait donc état d’une motivation spéciale, basée sur «la gravité des faits commis [par Marine Le Pen] en sa double qualité d’élue et de présidente d’un parti politique de premier plan ».
Outre cette motivation spéciale, cette décision n’apparaît pas non plus surprenante si l’on se fie aux précédents en la matière : force est de constater que la peine d’inéligibilité a largement été utilisée à l’encontre d’anciens députés ou politiques. Parmi ceux-ci, l’on peut notamment citer Henri Emmanuelli en 1997 (2 ans d’inéligibilité pour recel de trafic d’influence), Jean-Marie Le Pen en 1999 (1 an d’inéligibilité pour violences), Alain Juppé en 2004 (1 an d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts), Bernard Tapie en 1995 (3 ans d’inéligibilité pour complicité de corruption), Jérôme Cahuzac en 2018 (5 ans d’inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment), les époux Balkany en 2020 (10 ans d’inéligibilité pour fraude fiscale), ou encore Nicolas Sarkozy en 2024 (3 ans d’inéligibilité pour corruption et trafic d’influence).
En effet, cela s’explique et se justifie par la visée même de cette peine, étant de sanctionner et retirer du circuit politique les élus outrepassent leurs prérogatives, afin de restaurer un lien de confiance entre élus et électeurs.
B )La peine d’inéligibilité déroge-t-elle au caractère suspensif de l’appel ?
En principe, l’appel en matière pénal est suspensif, c’est-à-dire que le fait d’interjeter appel suspend l’exécution de la peine jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. Toutefois, cet effet suspensif ne vaut pas lorsque le tribunal a assorti sa décision d’une exécution provisoire (Art. 506 CPP)
En l’espèce, le tribunal correctionnel a prononcé l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, comme l’article 471 al.4 du code de procédure pénale en laisse la possibilité.
En outre, s’agissant de cette question particulière de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, il semble opportun de revenir sur la décision du Conseil constitutionnel rendue quelques jours auparavant, le 28 mars 2025, alors saisi d’une QPC concernant l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, et amené à se prononcer sur la conformité des dispositions issues de l’article 131-26-2 du code pénal.
Dans sa décision, le Conseil indique que les dispositions contestées mettent en oeuvre « l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » (§14), l’exécution provisoire de la peine permettant à la fois « d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive » (§13), mais également à « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants » (§14). Dès lors, le Conseil considère que, le juge pouvant en outre s’opposer au caractère obligatoire de la peine par une décision contraire spécialement motivée, les dispositions « ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité » (§18).
Le jugement du tribunal correctionnel rendu le 31 mars dernier poursuit donc la direction lancée par le Conseil constitutionnel, en condamnant la députée à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire.
Malgré tout, la députée du Rassemblement National ayant fait appel de ce jugement, un nouveau procès s'ouvrira durant l’année 2026 devant la Cour d’Appel de Paris, qui aura l’occasion de se prononcer à nouveau sur cette décision d’inéligibilité.
